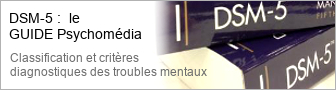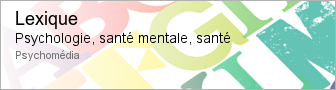Laboratoire de recherche en
écologie humaine et sociale
Université du Québec
Les recherches épidémiologiques nous indiquent depuis longtemps que le suicide ne se distribue pas tout à fait au hasard dans la population.Il y a des catégories de personnes plus susceptibles de s'enlever la vie et d'autres pour lesquelles les risques sont à peu près nuls. En santé publique, notamment pour les maladies contagieuses, les efforts de prévention s'articulent préférablement autour des personnes qui vivent dans un milieu où le vecteur de la maladie se propage. L'action porte principalement sur la vaccination si elle est disponible et sur la modification de leur mode de vie en vue de diminuer les possibilités de contact avec les sources de la maladie. Ce modèle médical a fait ses preuves et il a contribué à faire augmenter considérablement l'espérance de vie au cours du dernier siècle. Qu'en est-il du suicide et de l'application de ce modèle? Tout d'abord, comme le suicide n'est pas une maladie, il n'y a pas à proprement parler de vaccination possible. Ensuite, ce n'est pas une mort qui est occasionnée directement par le contact avec un vecteur ou une source de maladie. La situation s'apparente donc davantage avec d'autres types de mort violente comme les accidents routiers et les homicides. Et encore là, la comparaison avec les accidents routiers est sujette à caution. Le suicide est un geste volontaire, planifié, alors qu'un accident est le plus souvent occasionné par un facteur incontrôlable. Néammoins, on sait que les conducteurs impliqués dans des accidents routiers aident souvent leur cause en faisant abus de l'alcool, ce qui limite leurs facultés de conduite. Les mesures prises pour améliorer la sécurité des routes, la construction des véhicules à moteur ainsi que l'ajout de mesures de sécurité telles le port de la ceinture et le sac gonflabe ont largement contribué à diminuer sensiblement la mortalité sur la route. Mais l'élément le plus efficace a probablement été le contrôle sévère des personnes avec facultés affaiblies.
La prévention du suicide pose des défis beaucoup plus complexes que la prévention des accidents routiers. Alors que la très grande majorité des personnes qui décèdent sur la route auraient préféré demeurer en vie si elles en avaient eu le choix, nous avons, dans le cas du suicide, à arrêter dans son projet quelqu'un qui ne veut plus vivre, ou du moins ne veut plus vivre dans les conditions qui sont les siennes. Et contrairement aux accidents routiers qui se produisent à peu près uniquement sur les voies de communication et davantage à certaines heures de la journée, le suicide se produit aussi bien à domicile que sur la voie publique, en pleine nature aussi bien que dans le métro. Les actions directes sur l'environnement, tels la distribution des médicaments dangereux ou la circulation des armes à feu, enfreignent les droits et libertés d'autres groupes sociaux, ou sont difficiles à formuler comme dans le cas du métro de Montréal.
Il y a lieu cependant se se demander qui se suicide sur le territoire québécois et de rassembler le plus d'informations sur les caractéristiques personnelles des décès, telles la santé mentale, le type d'abus de drogue ou d'alcool, ou la trajectoire biographique comme les expériences adverses dans la famille d'origine, les événements de vie qui précèdent immédiatement ou le type de sous-groupe social d'appartenance.
Il faut opérer une distinction entre les catégories sociales à risque et les groupes à risque. Les études statistiques sur les grandes populations comme les rapports sur les taux de mortalité par suicide publiés par Stats Can ou par le MASS se font à partir des catégories sociales. On y constate entre autres que les hommes se suicident de 4 à 5 fois plus que les femmes, que les divorcés et les séparés se suicident plus que les gens mariés et que les jeunes adultes masculins ont les taux les plus élevés de toutes les catégories sociales. Ces statistiques sont intéressantes au plan descriptif mais peu utiles pour la prévention. Pour paraphraser Bronfenbrenner, ce sont des adresses sociales, des indicateurs grossiers. Ainsi, les jeunes hommes adultes représentent des centaines de milliers de personnes au Québec et, pour une personne de ce groupe qui se suicide chaque année, il y en a environ 3,000 qui survivront. Par ailleurs, la variable sociologique identifiée est le plus souvent une variable associée et non une cause directe. Par exemple, si les personnes séparées ou divorcées sont plus représentées dans les statistiques sur le suicide, c'est probablement parce que les les personnes en traitement psychiatrique sont plus nombreuses à échouer dans le mariage.
Les études qui rassemblent des informations sur les personnes qui se suicident à partir de leurs dossiers personnels ou en interviewant leurs proches fournissent des indications plus utiles pour la prévention. Les grands facteurs de risque identifiés sont l'abus de drogues et d'alcool, l'expérience d'une période de chômage chronique, la présence d'un trouble psychologique diagnostiqué (à ne pas confondre avec l'image de maladie mentale véhiculée dans le public) et, pour les jeunes, la présence d'un problème grave dans la famille. Là encore, ces facteurs ne font qu'augmenter la probabilité d'un suicide et la grande majorité des personnes qui possèdent un de ces facteurs ne se suicident pas. Pour qu'une personne en arrive à se suicider, il faut généralement une conjonction de plusieurs facteurs. C'est une des raisons pour laquelle la plupart des personnes qui abusent de drogues ou d'alcool, qui vivent une très longue période de chômage ou qui souffrent d'un trouble psychologique ne se suicident pas.
Nous sommes donc intéressés à identifier les groupes dont le risque relatif de se suicider est plusieurs fois plus élevé que celui de la population générale. Si, par exemple, la probabilité de mourir de suicide dans la population est d'environ 2%, celui d'un groupe à risque sera de quatre et vingt fois supérieur, et peut-être même davantage. À part les données sur les statistiques de mortalité, nous avons peu d'informations de cette nature pour le Québec. Nous pouvons cependant croire jusqu'à preuve du contraire que les conclusions tirées de recherches en milieu occidental ou nord-américain s'appliquent en grande partie au Québec. C'est un postulat universellement accepté en santé publique.
Alors qui sont donc plus précisément ces personnes qui sont à haut risque de suicide.
1. Les gens ayant fait une tentative avec dossier psychiatrique. L'un des groupes des plus à risque pour le suicide est constitué par les personnes ayant déjà complété une tentative et que l'on a jugé bon de référer en psychiatrie par la suite. Et le risque est d'autant plus élevé que la personne n'arrive pas à maintenir un emploi (Nordentoft et Rubin, 1993, Acta Psychiatrica Scandinavica, 88, 278-285). Une étude suédoise récente (Johnsson Fridell et coll., 1996, Acta Psychiatrica Scandinavica, 93, 151-157) qui a suivi un échantillon de tentatives sur cinq ans démontre que plus de 13% se sont suicidés durant cette période, et la plupart au cours des deux années suivantes. Le taux de récidive chez les survivants est de 40% et ceux-ci reçoivent tous un traitement psychiatrique de longue durée. D'autres auteurs proposent d'autre part que c'est la marginalisation et le rejet par les proches lors d'un incident récent qui rend vulnérable les personnes hospitalisées en psychiatrie.
2. Parenté de premier degré avec une personne suicidée. Il y a de 5 à 10% de la parenté de premier degré (parent ou enfant, frère ou soeur de mêmes parents biologiques) des suicidaires qui se suicide par rapport à un taux de base de 2% dans la population. Cela confirme que les endeuillés de la famille immédiate sont à haut risque. Nous ignorons la part respective attribuable à des facteurs génétiques ou au partage d'un milieu familial très perturbé et nous sommes même très loin d'une réponse qui sera satisfaisante. Il serait aussi très important de connaître la période de temps qui sépare ces suicides pour évaluer l'effet d'entraînement.
3. Jeunes à problèmes multiples. Les jeunes qui se suicident ont des problématiques sociales lourdes qui découlent souvent des situations familiales vécues au cours de l'enfance et de l'adolescence. Plus précisément, les jeunes qui abusent de drogues et qui passent par des familles ou des centres d'accueil sont plus à risque. Il semble également que beaucoup entrent dans une carrière d'itinérance.
4. Veufs marginalisés. Le décès du partenaire est une épreuve cruciale qui augmente le risque de décès par suicide chez les hommes. Cependant, il y a généralement un processus de rejet de la part de l'entourage. Dans des conditions normales, le veuvage est une dure épreuve de vie mais il n'est pas en soi une situation à risque.
5. Prisonniers récents. Les détenus à long terme ne sont pas nécesairement plus à risque. Cependant, il y a des données inquiétantes sur les détenus à titre préventif ou à courte durée. Beaucoup de détenus se suicident suite à une arrestation alors qu'ils vivent une crise importante dans leur vie (séparation maritale) ou qu'ils sont en sevrage d'une drogue. Les ex-détenus comptent un taux de tentatives graves élevé, plus de 50% selon une enquête de l'association Diogène à Montréal.
6. Abus de drogue et d'alcool. Il va sans dire qu'une consommation élevée de drogues et d'alcool recouvre souvent des dispositions dépressives profondes. Le risque relatif de suicide pour l'alcool varie beaucoup selonles études. Une étude norvégienne récente a suivi les dossiers de personnes traitées pour alcoolisme pendant 40 ans, ce qui a permis de conclure que le risque de suicide est sept plus élevé dans cette population que la dans la population générale. Le risque augmente par un facteur de 13 au-dessus de 40 ans (Rossow et Amundsen, 1995, Addiction, 90, 685-691). Il est certain qu'avec l'ajout d'autres facteurs comme un diagnostic de dépression, une séparation maritale récente, on arriverait à circonscrire un groupe assez restreint de personnes à risque très élevé. Le risque de suicide pour les personnes ayant été traitées pour abus de drogue est même plus élevé que pour l'alcool (Rossow, 1994, Addiction, 94, 1667-1673). Il est important de noter que les femmes jeunes, entre 15 et 24 ans, ayant été traitées pour abus de drogues ont environ 100 fois plus de probabilités de se suicider que les autres femmes de cet âge.
Conclusion
Ce bref survol nous indique que certaines catégories de personnes décédées par suicide n'appartiennent pas aux groupes qui font le plus souvent appel aux services généraux des organismes de prévention du suicide. Ceux-ci peuvent évidemment faire l'objet de programmes spécifiques. Il y a donc lieu de se demander de quelle façon répondre le plus adéquatement possible aux défis de prévention posées par ces sous-groupes qui apparaissent relativement diversifiés. Cela implique nécessairement une collaboration avec les personnes qui les traitent ou qui les prennent à leur charge dans des institutions (prisons, centres d'accueil) ou avec les personnes qui vivent dans leur entourage direct.
Il faut aussi prendre soin de ne pas mettre tous les efforts auprès des personnes qui cumulent un potentiel de suicide très élevé. On peut se demander s'il n'y a pas un moment lorsque les tendances suicidaires sont très fortes où il devient très difficile d'intervenir avec succès. La personne visée atteint alors un niveau de désespoir très élevé et l'entourage a cesse parfois de vraiment vouloir que la personne survive. À cet effet, beaucoup des gens qui se suicident sont déjà en traitement psychiatrique et cela ne semble pas avoir eu un effet positif déterminant. Mon opinion très personnelle en la matière est qu'on devrait accentuer davantage les efforts auprès des groupes à haut risque tout en continuant les démarches auprès des personnes moins en danger dont le risque peut éventuellement augmenter sans une attention adéquate.
Ce texte a également été publié dans Vis-à-vis, volume 7, no. 1, janv. 97, produit par l'association québécoise de suicidologie.